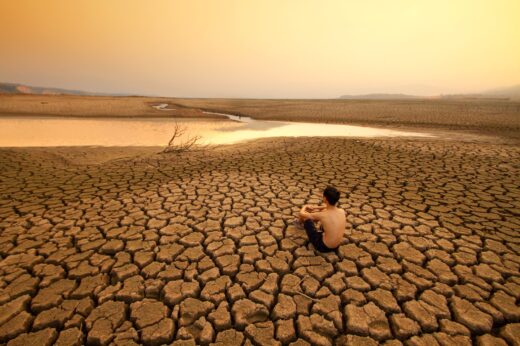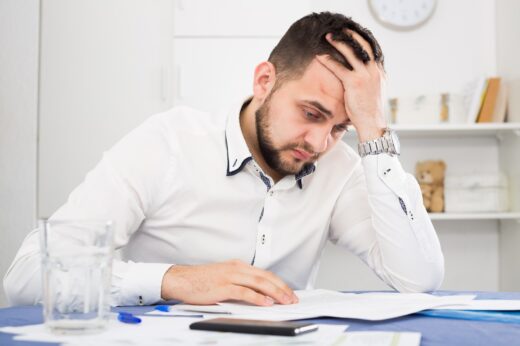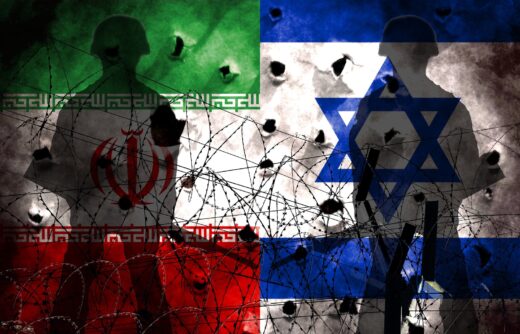Arrêts maladie prolongés : qu’est-ce qui pousse les salariés à s’absenter ?
- Ecoquick
- Actualité
- Emploi
- Politique
- Santé
Une étude récente menée par Predilife en partenariat avec IPSOS révèle les motivations derrière les arrêts maladie prolongés chez les salariés français. Alors que le bien-être au travail devient un critère majeur dans le choix…